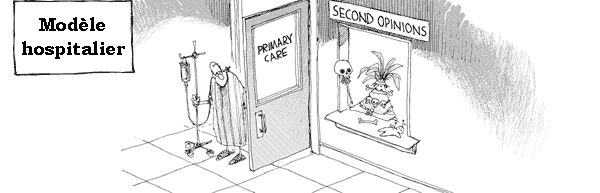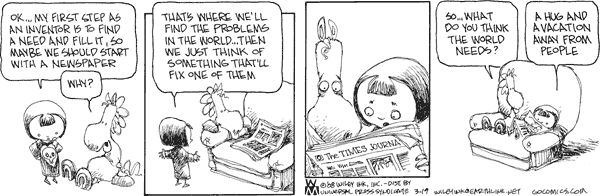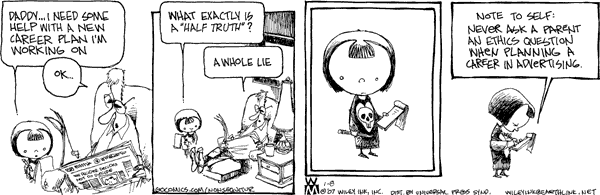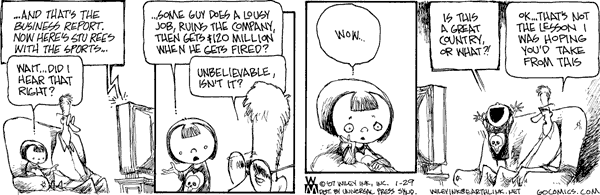« Jésus annonçait le Royaume, et c’est l’Église qui est venue. » a écrit Alfred Loisy, prédisant que le destin de la plupart des grandes espérances est d’être transformées en enfermement dogmatique : la promesse initiale perdure, mais détournée au profit d’un corps constitué qui la projette dans un univers futur et, conditionnant sa réalisation à une obéissance stricte aux règles qu’il institue, l’utilise pour régner dans le monde réel.
Parfaitement en phase avec l’actualité dans le domaine des systèmes d’information de santé, cette phrase constituera le coeur de mes prédictions pour 2009.
Il est aujourd’hui incontestable que le Dossier Médical Personnel est une victime supplémentaire de cette malédiction. L’espoir initial n’était rien moins que celui d’une nouvelle donne en santé grâce à l’ouverture d’un univers élargi à la fois dans le temps et l’espace par la mise en avant de la continuité des soins et la pleine intégration du patient au sein de son équipe de santé. Il a été durablement détournée au profit d’une caste technocrato-politique dont l’existence est désormais conditionnée par la prolongation jamais réalisée de cette espérance.
Que le nouveau patron du DMP, Jean-Yves Robin, ait parlé d’instaurer un « ordre nouveau » n’est pas anecdotique ; si on lui fait grâce de la maladresse qu’il y avait à utiliser une expression historiquement connotée, il reste l’annonce d’une phase où la norme doit primer l’invention – où l’Église va établir la Règle.
Il n’est pas anodin non plus que les annonces récentes du Conseil National de l’Ordre des Médecins partent de l’analyse que « l’échec de la conception du dossier médical personnel (DMP) est probablement dû à une construction intellectuellement très intéressante mais extrêmement complexe » et qu’il faut désormais se concentrer sur des solutions « pragmatiques et simples ». Le Royaume promis puis perdu par la maladresse des technocrates qui s’étaient réservé l’exclusive de sa découverte est désormais habillé des oripeaux de l’espérance exagérée. Il serait devenu pragmatique de cesser de rêver et de s’attacher à des tâches banales.
Cette castration annoncée de l’inventivité est particulièrement choquante dans un univers des nouvelles technologies où, en paraphrasant Jules Vernes, « rien ne s’est fait de grand qui ne soit une espérance exagérée ». Le grand malheur du domaine de la santé c’est qu’aujourd’hui ces « solutions pragmatiques et simples » conviennent idéalement à l’ensemble des acteurs :
- Les médecins, qui sont d’autant moins enclins à se projeter dans l’avenir qu’ils sont toujours plus absorbés par le fardeau quotidien, et restent encore mal à l’aise avec le « patient empowerment ». Enfermés dans une boite qu’ils voient rétrécir, ils ne songent pas à s’en échapper mais rêvent avant tout de solutions professionnelles où leurs habitudes personnelles deviendraient la norme (« mon dossier mis en ligne »).
- Les technocrates, peu à l’aise avec l’innovation, mais en majesté lorsqu’il s’agit d’utiliser des normes pour piloter des réunions de maitrise d’œuvre, de maitrise d’ouvrage, d’urbanisation de systèmes d’informations et tous autres concepts de « puzzle makers ».
- Les industriels du domaine, qui pensent qu’il est enfin temps de vendre à grande échelle ce qu’ils ont mis au point au sein des hôpitaux ou de l’environnement « banque – assurance ».
Que va-t-on voir en 2009 ?
Avec un contexte aussi défavorable, mes 5 prédictions 2009 ne sont pas roses. Pour les résumer laconiquement, le déficit de matière grise nous condamnera à broyer du noir.
Dans le domaine des systèmes d’information 2009 sera marqué par la multiplication des systèmes KISS (Keep It Simple and Stupid) et l’uniformisation normative. Dans le domaine concret, l’augmentation de la charge de travail des professionnels ira de pair avec une perte de repères massive. De façon globale nous verrons se renforcer le cercle vicieux qui veut que le poids toujours plus lourd du quotidien dans cette enceinte confinée laisse de moins en moins de place à l’innovation qui permettrait de sortir de la boite.
KISS me, I am famous
À l’exemple du Dossier Pharmaceutique (DP), 2009 verra la multiplication des initiatives d’« excellence à courte vue ». Il sera investi des millions d’euros dans la gestion à grande échelle de sujets limités, comme l’interaction médicamenteuse.
La phase d’expérimentation du DP est considérée comme un succès par la volumétrie d’informations échangées. Il va donc être étendu à l’ensemble du territoire sans qu’aucune étude d’efficacité métier n’ait été menée. L’informatique semble rester un domaine « magique » en santé puisqu’il suffit qu’une solution soit fonctionnelle pour être considérée comme utile !
Et pourtant. Pourtant, si on analyse les ressorts de l’interaction médicamenteuse, on peut s’inquiéter de l’existence d’un tel outil.
Tout d’abord, c’est enfoncer des portes ouvertes que d’affirmer que tout médicament est potentiellement dangereux… raison pour laquelle sa dispensation fait intervenir un médecin et un pharmacien. Prescrire et délivrer, c’est donc analyser les possibles effets néfastes, et estimer que le risque du traitement est inférieur à celui du placebo ou de l’inaction.
Se concentrer sur l’interaction, c’est donc ne prendre en compte qu’une petite partie de ce risque en choisissant de travailler sur le sous-domaine facilement informatisable où on ne considère que la combinaison de médicaments sans faire intervenir la physiologie du patient (on pourra m’objecter que le patient intervient au travers de ses allergies connues et déclarées, mais il est alors réifié au rang d’un médicament comme les autres – qui cohabite mal avec certains).
Rien n’empêche, par ailleurs, d’associer dans une même prescription des produits qui possèdent une interaction signalée ; c’est même très fréquent. Idéalement, cette prescription devrait être systématiquement accompagnée de la mise en place des procédures adaptées de gestion du risque. Ce qui signifie que tous les acteurs concernés doivent être conscients du niveau de risque et des actions qui permettent de le maintenir à un niveau acceptable au cours du temps et de discerner précocement les éventuels problèmes.
Continuité des soins, équipe de santé, prise en charge partagée du risque… on est aux antipodes d’un produit limité à la seule vision du pharmacien et généraliser le DP, c’est tourner le dos aux solutions véritables des problèmes qu’on prétend résoudre.
Évidence supplémentaire, de très nombreux accidents « iatrogènes » sont dûs aux anticoagulants, et ne sont pas imputables à un phénomène d’interaction mais bien à des défauts de la chaine de gestion du risque au sein d’équipes de santé trop virtuelles pour être efficaces. Lorsque chacun des acteurs aura son volet spécialisé au sein de la panoplie d’outils qui vont malheureusement naitre dans les mois qui viennent, ce problème fera que s’accentuer.
La Norme
La multiplication des projets ciblés (« de spécialité ») et régionaux est en parfaite contradiction avec le dessein initial du DMP, qui se voulait global et national.
Fort heureusement, même les enfants savent transformer un ensemble disparate de points en un dessin harmonieux : on relie les points entre eux de façon à obtenir un motif plausible, puis on colorie le tout. Avec un peu d’imagination et quelques points, on arrive toujours à « dessiner un mouton » !
Chez les artistes du DMP, la magie s’opère en créant l’illusion que les expériences ponctuelles et disparates sont extensibles ; qu’il s’agit de tester des normes qui seront ensuite imposées au reste du domaine.
Malheureusement, les expériences récentes nous démontrent toutes qu’en médecine une expérience ciblée n’est jamais extensible. Il faut se souvenir que l’échec des réseaux de soins a, avant tout, été entériné par la constatation que la multiplication des approches verticales ne permet pas de couvrir le spectre horizontal mais, au contraire, crée des goulets d’étranglement en tout point où ils est attendu des acteurs généralistes qu’ils adoptent un angle de vision spécialisé. En résumé, si l’implantation isolée d’un réseau est souvent un succès ; leur multiplication ultérieure est toujours un échec.
Les magiciens tentent généralement de résoudre cette problématique par deux approches :
- exhiber le concept de « dossier minimal commun » (DMC). Le DMC est un concept magique au sens propre du terme ; chimère de l’informatique de santé qui évolue toujours naturellement vers le « presque tout » ou le « presque rien ».
- ne pas faire intervenir d’acteurs généralistes ; après tout, pourquoi ne pas utiliser le réseau pour constituer des filières d’expertise ? C’est tout le principe des systèmes KISS qui vont faire florès en 2009 !
Les systèmes KISS seront donc déguisés pour l’occasion en expériences extensibles. Il sera alors possible de faire de même avec les SIH acquis dans le cadre du plan Hôpital 2012 !
Pour qui s’intéresse aux trajectoires des patients, l’hôpital est modélisable par un échangeur autoroutier à multiples niveaux. Ces niveaux sont faiblement connectés entre eux puisque les différents services traitent des patients de trajectoire distinctes, et ils sont très faiblement connectés au réseau général : le patient arrive comme « vierge » et sera perdu de vue dès qu’il aura franchi le seuil.
En conséquence, les systèmes d’information hospitaliers (SIH) existants sont terriblement obsolètes ; très faiblement fonctionnels, ils se concentrent sur quelques processus métiers verticaux (gestion de l’imagerie avec les PACS, gestion de la pharmacie et de la prescription…). La majeure partie de l’information reste stockée sous forme de documents Word et la vision qu’ils donnent d’un patient est limitée au laps de temps qui sépare son entrée et sa sortie.
Intégrer les hôpitaux aux processus de continuité des soins est donc un défi complexe. Il n’a pas été tenté précédemment et ne le sera pas en 2009. Autant il est complexe de connecter les échangeurs isolés ici et là aux « réseaux routiers » des trajectoires de continuité des soins, autant il est intellectuellement simple d’imaginer que l’ensemble du domaine puisse être modélisé comme un échangeur géant : il suffit, après tout, de considérer la ville comme un service externe !
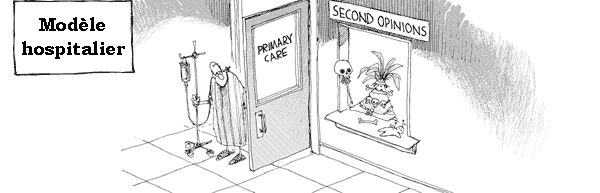
Je peux prédire avec un très bon niveau de confiance que c’est le processus qui sera mis en oeuvre en 2009. Tout d’abord parce que les seuls acteurs « industriels » du domaine sont issus du monde hospitalier, qu’ils piaffent d’impatience de généraliser leurs solutions et parlent le même langage que la plupart des décideurs administratifs, également issus de cette filière. L’autre élément fort réside dans le fait que, pour les mêmes raisons, les seules normes du domaine proviennent du secteur hospitalier. HL7, par exemple, est promis à un avenir d’autant plus radieux que, comme je l’ai montré dans un billet précédent, les principaux éditeurs de logiciels de gestion de cabinet se sont déclarés prêts à intégrer toutes les normes souhaitées par la tutelle – en échange d’une labélisation qui leur permettrait de fermer le marché derrière eux.
L’espoir initial du DMP était que la mise en place d’un système d’information collectif allait désenclaver, faire sortir de leur boite, les systèmes locaux. Résumé en terme énergétique, 2009 verra entérinée la victoire de l’inertie sur le mouvement : l’éclatement fonctionnel et régional du DMP renforcera l’orthodoxie du modèle hospitalier.
Ainsi, les milliards d’euros du plan Hôpital 2012 seront consommés à mettre en place des systèmes d’informations autistes qui prétendront faire des hôpitaux le coeur d’un pseudo-DMP loco-local ou loco-régional. Massivement ancré dans un modèle oû le portail hospitalier sera la rêgle, le secteur médical deviendra encore plus difficile à faire évoluer vers les concepts de continuité des soins qui, en 2012, seront probablement devenus une exigence banale des patients.
Partout ailleurs vecteur du progrès, le système d’information sera utilisé en santé à figer une organisation obsolète. Faisant obstacle au changement de paradigme qu’il devrait outiller, ce hiatus du monde virtuel pèsera d’un poids considérable tant en terme de qualité des soins que de coût de la santé ; il faut s’attendre à de cruelles répercussions dans le monde réel, où l’absence de réformes nécessaire s’ajoutera aux effets d’une crise économique de grande ampleur.
Le médecin débordé en première ligne
Les déterminants sociaux de la santé sont assurément les parents pauvres de la recherche médicale.
Même si c’est un résumé un peu lapidaire, on pourrait probablement affirmer que notre civilisation, tournée vers une acception technique de la notion de progrès, a préféré expliquer l’augmentation de la durée de vie par le formidable essor des technologies médicales plutôt que par l’amélioration de l’hygiène et le progrès social.
Des voix convergentes proposent une vision nouvelle. Dans cette veine, le Docteur Jacques Hidier a publié en 2008 sa « Chronique de mortalité » où le dialogue virtuel entre deux médecins situés à 100 ans de distance met en perspective progrès médical et progrès social. Les courbes d’espérance de vie en France publiées par l’Institut National d’Études Démographiques (INED), qui m’ont été signalées par le Docteur Jean-Pierre Mariani, montrent une évolution linéaire bien peu en phase avec l’évolution considérable des techniques de soins.

L’OMS ne craint plus d’affirmer que l’injustice sociale tue à grande échelle, et qu’un gamin de la banlieue de Glasgow peut avoir une espérance de vie réduite de 28 ans par rapport au même enfant né… à 13 kilomètres de là.
Dès avant la crise, la presse a annoncé que, faute de moyens, un pourcentage non négligeable de nos compatriotes avaient dû renoncer à certains soins médicaux. En 2009 le monstre froid de la crise va malmener les âmes et faire souffrir les corps.
Chef de service et chef du pôle de médecine au sein d’un hôpital de banlieue, une amie me disait récemment combien elle a vu le tissu social environnant se dégrader ces dernières années ; l’argent manque désormais pour les besoins de base, et elle voit de plus en plus fréquemment des patients qui peinent à se nourrir.
Perte de repères
En parallèle, sa charge de travail ne fait qu’augmenter, avec un poids administratif toujours plus lourd et une vraie difficulté à retrouver du personnel compétent lorsqu’un membre du service migre vers des cieux plus cléments. À dépenses et revenus constants, son hôpital, qui affichait un bilan légèrement bénéficiaire en 2007, annoncera un déficit de plusieurs millions d’euros en 2008. La tutelle a modifiè les règles comptables et il va probablement falloir réduire des charges de personnel déjà insuffisantes… avec à la clé la perspective d’interminables réunions administratives !

Déjà harassés et déboussolés par la « créativité » sans cesse renouvelée des directives administratives, les médecins, qui constituent la première ligne de la crise, ont de fortes chances d’être débordés.
Report de l’innovation
Le philosophe Jean-Pierre Dupuy vante les mérites du « catastrophisme éclairé » ; de l’exposition la plus précise possible des causes et des conséquences afin d’outiller ceux qui seront en position de rendre ces prédictions fausses. « Le catastrophisme éclairé est une ruse qui consiste à faire comme si nous étions victimes d’un destin tout en gardant à l’esprit que nous sommes la cause unique de notre malheur. » affirmait-il au magazine l’Expansion.
En prédisant que 2009 sera l’année du renforcement des nombreux cercles vicieux qui faisaient déjà du domaine médical un secteur en difficulté dès avant la crise, j’ai avant tout cherché à exposer les modèles de pensée (mais malheureusement pas de panser) qui étayent ces annonces.
Il serait illusoire d’imaginer que les politiques actionneront rapidement le levier de l’innovation, seul moyen de briser ces enchainements, mais il n’est pas inutile d’analyser les causes de l’impéritie politique qui a en est la cause.
L’histoire du DMP montre jusqu’à la caricature que la politique en médecine est un jeu de dupe entre trois acteurs : le ministère, l’administration et le parlement.
Le ministère change de vision à chaque remaniement ministériel et fixe à l’administration des objectifs synchrones avec le calendrier électoral, par exemple « Un DMP pour chaque Français en janvier 2007 ». Même lorsque ces objectifs sont aberrants, il se trouve toujours un individu à l’ego surdimensionné pour accepter de relever le défi en prenant la tête d’un « machin administratif » (agence, GIP, regroupement d’agences et de GIPs…). Fort de la volonté du ministre et de la confiance de l’administration, l’exécutif demande alors aux députés de voter les lois nécessaires.
Il faut admettre que les députés se sont, ces dernières années, révélés fort enclins à croire les histoires improbables qui leur étaient racontées. Au point même de voter puis de conserver dans la loi des mesures de pénalités en cas de non usage d’un DMP… qui n’existe pas et n’existera probablement jamais !
La petite histoire politique fait que Xavier Bertrand, à qui on doit l’échec du DMP historique, vient de devenir secrétaire général de l’UMP, tandis que Jean-François Coppé, qui ne le porte pas particulièrement dans son coeur est inamovible pendant 5 ans à son poste de président du groupe UMP à l’assemblée et prétend faire du bloc législatif un « soutien critique » de l’exécutif.
Bref… on peut espérer que les députés auront dans le futur une vision autrement plus critique des affirmations de l’administration, y compris des résultats d’audits internes qui, même lorsqu’ils en critiquent les pitoyables résultats, perpétuent le confinement du « jeux à trois ».
Malheureusement, cette potentielle indépendance retrouvée du législatif n’aura pas encore d’influence en 2009. C’est aux États-Unis, de l’administration Obama et de géants comme Google, qu’il faut attendre une réponse politique à la crise. Les solutions testées outre-atlantique déferleront probablement en 2010, laissant, de toute façon, bien peu de latitude à ceux qui seront alors en position de prolonger ou non l’illusion du confinement administratif de l’innovation en santé.