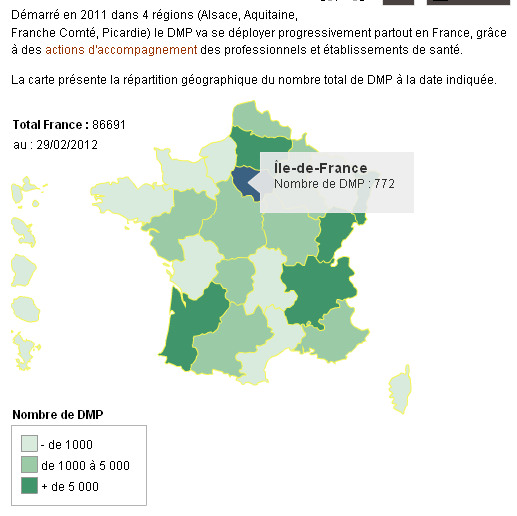Mercredi 16 Mai, Antonio Casilli a clos son cycle de séminaires de l’EHESS 2011/2012 (sous la bannière « étudier les cultures du numérique : approches théoriques et empiriques ») par une belle conférence de Dominique Cardon.
Contexte savant, puisque Dominique Cardon est à la fois sociologue au Laboratoire SENSE (Orange Labs), chercheur associé au Centre d’études des mouvements sociaux (CEMS/EHESS), animateur de la revue Réseaux et auteur du livre La Démocratie Internet. Promesses et limites (Seuil, 2010).
Titre énigmatique « Dans l’esprit du PageRank. Un essai d’anthropologie de l’algorithme de Google ».
Le résultat, c’est 3 pages de notes pour une grosse heure de présentation, signe d’un discours dense et édifiant… que je vais tenter de retranscrire ici.
Introduction
L’ambition de Dominique Cardon est de scruter le web au travers des métriques qui l’organisent et des algorithmes qui les mettent en œuvre.
Sa recherche sur le Page Rank de Google s’appuie sur une lecture extensive, elle même mise en perspective sur le socle théorique des travaux sur le web politique, fortement influencé par Habermas.
L’espace politique idéal, dont le web pourrait être un exemple, est alors caractérisé par deux critères :
- une expression libre et sans contrainte,
- la force intégratrice de la discussion.
Si on peut s’accorder sur la validité du premier point, le second fait largement débat, Habermas ayant lui-même affirmé dans un discours que l’Internet est qualifié par « la fragmentation de petites niches de discussion qui n’arrivent pas à se coordonner ». Pour Dominique Cardon, les métriques et algorithmes qui classent les informations sont précisément le « lieu » où se produit cette intégration si cruciale… et méritent donc une étude attentive.
Cinq grands principes sont à la base des algorithmes qui organisent aujourd’hui le web :
- éditorialisation, le classement « manuel » par des opérateurs humains, « à la Yahoo »,
- moteurs de recherche,
- mesure d'audience,
- affinité, par exemple en fonction du volume d’abonnements sociaux,
- vitesse, classement par fraîcheur, le plus récent au dessus.
Si les trois premiers principes existent sur tous les médias, les deux derniers sont spécifiques des réseaux sociaux. La plupart des métriques qui animent les recherches au sein des sites sont bâties par agencement de ces cinq principes.
Dans l’esprit du Page Rank
La question clé posée par Dominique Cardon, sous le titre Dans l’esprit du Page Rank est « quelle est l’idée que se fait Google du web et du monde ».
L’origine du Page Rank apparaît quasi-simultanément dans la publication de Jon M. Kleinberg « Authoritative Sources in a Hyperlinked Environment » et dans celle de Brin et Page « The Anatomy of a Large Hypertextual Web Search Engine ». Son principe est de rompre avec la stratégie utilisée par les moteurs de recherche d’alors, basée sur l’analyse sémantique des pages, en partant de l’idée que, au travers des liens qui caractérisent l’environnement hypertextuel, ce sont « les pages qui parlent aux pages » et qu’il n’est pas besoin d’exhiber une logique supérieure de catégorisation.
Pour le dire plus simplement, plutôt que de tenter de trier les pages en fonction d’une arborescence artificielle de catégories, il suffit de mesurer la façon dont la connaissance s’associe (par lien hypertexte) à la connaissance. C’est une logique dite « démocratique » ; en réalité largement méritocratique puisque toutes les pages ne sont pas dotées de la même autorité.
Ainsi, le monde statistique que « dessine » le Page Rank est basé sur une forme de miracle de l’intégration réalisé par l’intelligence des foules d’internautes qui publient. Cette qualité « issue de la multitude » est, par exemple, conforme à la constatation faite par Wikipédia que les articles les plus en accord avec les critères de qualité du site sont généralement ceux qui ont le plus de contributeurs.
Dominique Cardon envisage ce mécanisme sous deux angles, une version « de gauche » et une version « de droite ».
Dans la version de gauche, décrite par Yochai Benkler, le mécanisme à l’œuvre est celui de la coordination d’actions inconscientes. Les bases du raisonnement sont fournies de longue date, par ailleurs sans rapport entre elles, par Galton (avec son expérience du poids d’un bœuf mieux approché par la moyenne des évaluations naïves que par chaque expert) et par le théorème du Jury de Condorcet, qui établit que, sous certaines conditions (que la bonne réponse ait plus d’une chance sur deux de se produire, qu’il n’y ait pas d’influence d’un votant sur l’autre et que les votants soient sincères dans leur choix), la décision du groupe est supérieure à celle de chaque individu, et sa qualité augmente avec la taille du groupe.
Dans ce cadre, le Page Rank intervient comme moteur du « modèle par la discussion » où les éléments les plus saillants des micro-discussions de niche parviennent à remonter dans des sphères plus larges qu’elles ensemencent, et ainsi de suite en faisant remonter vers le niveau global le meilleur grain des discussions locales.
Dans la version de droite, c’est le théorème de la diversité de Scott Page et la logique du marché prédictif qui servent de modèle en posant qu’il y a deux dimensions à la capacité d’un groupe à faire des prédictions intelligentes : le niveau d’expertise individuelle des membres du groupe et la diversité de leurs opinions (voir l’article de la revue Clés De Gustave Lebon à James Surowiecki : bêtise ou sagesse des foules ?).
On peut augmenter la performance prédictive du groupe en jouant sur l’une ou l’autre, ou sur les deux à la fois en attirant les opinions les plus diverses possibles, de la part de gens intéressés et même passionnés – comme le sont forcément des parieurs. Un marché prédictif attire donc les gens qui ne sont pas forcément experts, mais qui se croient bien informés (et le sont parfois), et il les pousse à oser être originaux et à ne pas être d’accord entre eux, pour parier les uns contre les autres dans l’espoir de remporter le gros lot (d’où une diversité d’opinion).
Le Page Rank est alors le moteur d’arbitrage qui, dans ce marché prédictif des opinions, permet une convergence similaire à la « main invisible » d’Adam Smith sur les marchés financiers.
Limites du modèle
Dominique Cardon insiste sur le fait que cette mécanique n’est opérante que si les acteurs ne se préoccupent pas de l’existence du Page Rank. Toutes les stratégies de Search Engine Optimization (SEO) qui visent, par des artifices multiples, à améliorer le classement d’une page contrarient le « miracle de l’agrégation » ; comparables à des délits d’initiés, ils amènent Google, qui se veut au sens propre comme au sein figuré la « main invisible » du processus, à faire sa propre justice en dégradant violemment certains sites suspectés de triche.
Google est ainsi à la fois l’ordonnanceur du Web, avec un algorithme qu’il garde secret, et le juge des bonnes pratiques, avec des adaptations non moins secrètes du même algorithme. Considération aggravante, c’est également un acteur du domaine, que ce soit par ses autres initiatives ou, surtout, par la vente d’espaces publicitaires.
Google affirme conserver un mur étanche entre le « monde organique » du web trié par le Page Rank et le « monde stratégique » des liens commerciaux. C’est une chose de faire une confiance aveugle à Google dans ses affirmations de n’avantager ni ses propres pages ni celles de ses meilleurs clients, c’en est une autre d’imaginer que la barrière soit si étanche entre un monde organique idéalement désintéressé et un monde stratégique qui resterait alors le seul espace de jeu des calculateurs.
Par ailleurs, que le modèle soit « de droite » ou « de gauche », l’Internet documentaire tel qu’il est rêvé par Google pour constituer un « espace efficient » pour le Page Rank possède une topologie de rhizome non organisé.
Pourtant, dans la réalité, 90 % du Page Rank global est réparti sur 10% des sites, situation entretenue et aggravée par l’effet Mathieu (ou effet d’avantage cumulatif) qui veut que les sites les plus visibles sont également ceux qui attirent les connexions des nouveaux entrants. Par ailleurs, la règle implicite des attachements préférentiels, qui veut qu’on « ne cite jamais plus petit que soi » aspire le Page Rank des petits sites (qui citent les gros) vers les gros (qui ne citent pas les petits).
De façon contradictoire, le Web, par l’effet du Page Rank, est donc beaucoup plus hiérarchisé et moins rhizomatique que le monde cible de Google.
L'irruption du « Web social »
L’irruption massive des réseaux sociaux, dans le sillage de l’emblématique Facebook, fait basculer le Web documentaire vers l’Internet des personnes et s’accompagne en conséquence d’un tropisme pour le classement par affinité.
Pour Dominique Cardon, la mécanique profonde du Web documentaire opère par transfert de la qualité d’un auteur à sa production ; à la façon dont le talent d’un écrivain matérialisé sous forme d’un livre permet à cet ouvrage de recevoir le Prix Goncourt.
Dans un univers hypertexte, les pages sont reliées entre elles par des liens qui matérialisent une forme de reconnaissance de valeur. Dans ces conditions, on peut modéliser le Web comme un espace autonome de documents qui emmagasinent le talent de leurs auteurs et peuvent en transférer une partie à d’autres documents par la « tuyauterie » des liens. Le Page Rank mesure alors la qualité dynamique issue de ces échanges dans un monde des documents mathématiquement parfait… car isolé de tout artifice humain.
Par ailleurs, c’est un monde relativement élitiste puisque seuls les internautes qui publient participent à l’évaluation de la qualité.
Avec la floraison des boutons « I Like It », la qualité est jugée en direct par des internautes au sein d’un cercle qui n’est plus restreint à ceux qui publient. La qualité s’attachent alors aux personnes. Comme l’exprime Dominique Cardon, on porte des badges, on investit dans la production du jugement une valorisation de soi-même.
L’application de ce principe donne vie à une nouvelle métrique, le Edge Rank, qui classe les documents en fonction des liens entre les personnes.
Conclusion
Le monde idéal du Page Rank était l’univers des documents. Par la pratique du mode rédigé, qui induit une distance suffisante entre le sujet et le sujet auteur et donne au document une qualité autonome, ce monde était partagé de façon étanche entre un domaine organique non marchand et un domaine stratégique marchand.
Le Web des personnes, au contraire, est intégralement expressif, c'est-à-dire pleinement calculateur et sensible aux pratiques complexes des sociétés humaines comme le « renvoi d’ascenseur ».
Dominique Cardon entame, par l’étude du web en fonction de ses métriques, un travail de recherche passionnant.
Mon grain de sel
En écrivant cet article, suis-je simplement sensible au mouvement « Publish What You Learn », sans autre idée que de produire un document de bonne facture… ou bien ai-je en tête de l’utiliser pour me valoriser au sein des réseaux sociaux ? Pur idéalisme ou pur calcul ?
Comme il n’existe pas de monde où les documents, détachés de leur auteur, danseraient ensemble le Page Rank, ni de société humaine fonctionnelle sans qu’il y existe un espace didactique désintéressé, je me permets d’affirmer que tout discours publié sur le Web procède simultanément des deux intentions, éclairer autrui et se valoriser.
Dans ce contexte, le Page Rank et le Edge Rank mesurent alors le succès de ces deux intentions et le monde idéal devient le lieu où celui qui avait pour but d’édifier humblement obtienne un bon Page Rank tandis que celui qui cherchait à se mettre en avant avec une production simplement voyante ou provocante voit son Edge Rank augmenté.
En prenant un peu plus de recul, je vois la démarche de Dominique Cardon comme la quête fondamentale qui consiste à analyser un espace d’échanges (le Web, ou plutôt les Webs, si on distingue ses dimensions documentaires et sociales) en fonction du mécanisme de mesure de la qualité qui s’y applique.
Comme je l’ai souvent écrit, je suis sur ce sujet un adepte de Robert M. Pirsig et de la façon dont il a défini la Qualité (avec un Q majuscule) dans son roman « Traité du zen et de l’entretien des motocyclettes » : la Qualité est la fusion de l’âme et du savoir faire technique. Le principe qui fait de l’œuvre la prolongation naturelle de la main de l’artisan ou du cerveau de l’inventeur. Elle s’oppose à la vision dualiste usuelle qui distingue fortement le concepteur et la conception, le sujet et l’objet.
Comme l’explique Pirsig, « au moment de la perception de la Qualité pure ou, sans même parler de perception, au moment de la Qualité pure, il n’existe ni sujet ni objet. Il n’existe qu’un sens de la Qualité – d’où naîtra plus tard la conscience du sujet et de l’objet. Au moment de la Qualité pure, sujet et objet sont identiques. […] Cette identité est la base même du travail artisanal, dans tous les arts appliqués. C’est elle qui manque à la technicité moderne, fondée sur une conception dualiste. Le créateur ne s’identifie nullement à ce qu’il crée, le consommateur ne s’identifie pas à ce qu’il possède ».
Nous sommes très proches de la maxime de Jacques Puisais (œnologue créateur de l’Institut du Goût) : « Un vin juste doit avoir la gueule de l’endroit où il est né et les tripes de celui qui l’a fait ». Ainsi, une « bouteille de Qualité » rassemble dans un même flacon le vigneron, sa terre et son vin.
Que le Web actuel propose des « métriques de la qualité » qui ne fonctionne que dans le monde des documents ou uniquement dans l’univers du jugement de surface du « I Like It » me semble amplement démontrer son immaturité. Immaturité qui, avec mes critères d’analyse – qui tiennent qu’un produit réussi ressemble à son auteur – est parfaitement illustré par les géants actuels du web : que ce soit Marc Zuckerberg ou Brin et Page, ce sont des êtres qu’on peut probablement qualifier de géniaux, mais dont l’humanisme est limité à la portion congrue.
En parallèle au Web « de la maison de verre » où Facebook et Google tentent de nous convaincre que l’intimité est un concept dépassé, il est urgent de créer un Internet humaniste.
Et après tout, s’il fallait, pour le construire, prendre le contrepied de la mécanique actuelle dominée par de jeunes Geeks étasuniens, ce serait un magnifique défi à relever pour les citoyens mûrs de la vieille Europe.