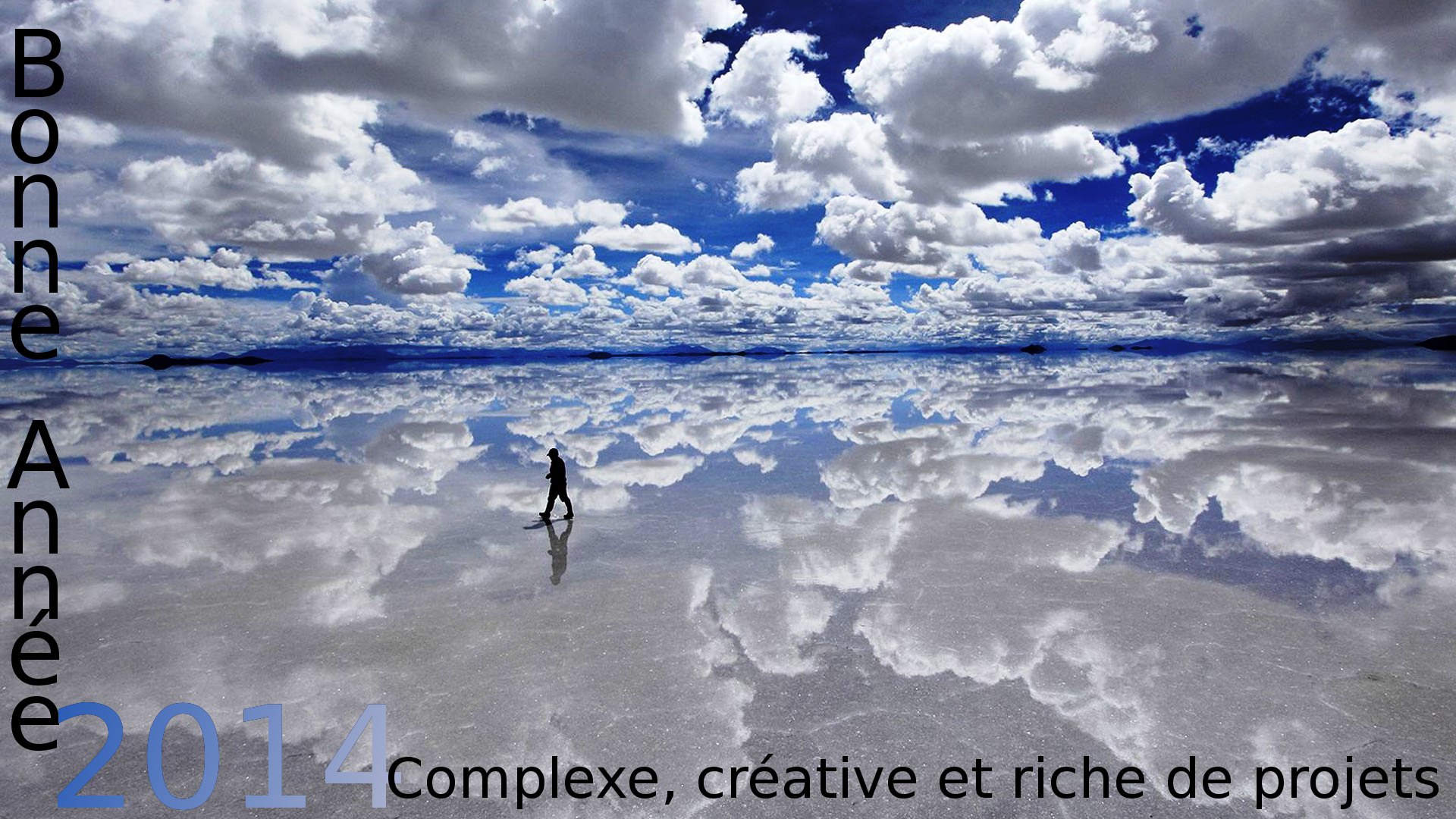Il existe depuis toujours une forte dissymétrie de gestion d’information entre le citoyen et ses prestataires. La boîte à chaussures ou le sac plastique bourré de documents d’un côté, des logiciels métiers dédiés de l’autre. C’est l’un des grands espoirs du web que de combler ce fossé. Dominique Cardon évoque superbement ce mouvement dans l’introduction de son livre « La démocratie Internet » :
Internet élargit l’espace public. […] Ce livre voudrait montrer que cet élargissement procède de deux dynamiques orthogonales : Internet pousse les murs tout en enlevant le plancher. Il ôte d’abord le privilège d’accès à la publication dont bénéficiaient naguère les professionnels. L’apparition des amateurs sur la scène publique étend considérablement le périmètre du débat démocratique. La parole publique ne reste plus sans réponse, dans une posture d’autorité imposant à son public silence et déférence. Elle peut désormais être commentée, critiquée, raillée, transformée par un grand nombre de personnes autrefois jugées inaptes ou ignorantes. Mais Internet aspire aussi dans l’espace public les expressions personnelles des internautes. Le web s’empare de conversations qui n’étaient pas reconnues comme « publiques », en profitant des nouvelles pratiques d’exposition de soi des individus. La ligne de partage entre sociabilité privée et débat public est trouée par une nouvelle sensibilité qui conduit les individus à s’exposer et à tisser, devant les autres, des fils entre leur vie personnelle et les enjeux publics.
Le Dossier Médical Personnel, qu’il le veuille ou non, est contemporain de ce mouvement de fond qui voit l’individu, maintenant doté d’un accès à l’information et placé en position de suivi de sa santé ou de celle d’un proche, espérer trouver un outil à la hauteur de cet enjeu.
Pourquoi le DMP est inutile
Le DMP « Bertrand 1 », dont le but était de contrôler les examens redondants et de diminuer la iatrogénie était totalement inscrit dans une logique de surveillance ; le même DMP, dans son actuelle mouture « Bachelot – Bertrand 2 », a une justification bien plus à la mode, la continuité des soins. L’enjeu est d’importance puisque la continuité des soins c’est l’organisation au long cours, pour une personne, de sa trajectoire de santé.
Comme l’évoque Dominique Cardon la ligne de partage entre « pour une personne » et « par une personne » est désormais « trouée par une nouvelle sensibilité » qui, en santé (et même en médecine), naît d’une nouvelle capacité d’accès à l’information mais aussi de nouvelles contraintes de société, par exemple la prédominance des pathologies chroniques, les enjeux de la dépendance dans un contexte d’évolution défavorable de la disponibilité médicale.
Autant le dire tout de suite, le DMP réel, celui que l’ASIP tente actuellement à toute force de « généraliser », est aux antipodes de ces préoccupations. C’est un système basé sur la mise en œuvre de normes de gestion documentaires issues du monde hospitalier et dont l’objet principal est de permettre à un médecin d’accéder aux documents disponibles pour un patient donné.
L’échec du DMP est entièrement résumé dans ces quelques lignes… mais passe facilement inaperçues tant les mots ont un sens élastique dans le domaine. Détaillons.
Le premier mot qui pose grandement problème est « patient ». Le patient (du latin pateor, souffrir) est le terme employé par un professionnel du domaine médical pour désigner une personne en souffrance (malade ou craignant de l’être). Disons le simplement, le mot patient désigne une personne vue par les yeux d’un acteur clinique ; c’est-à-dire socialement nue et, plus souvent que nécessaire, physiquement les fesses à l’air.
Le second mot qui pose problème est « document ». L’échange de documents est depuis toujours le moyen de transfert d’information utilisé en médecine.
Le schéma fonctionne plutôt bien pour les pathologies aiguës simples : vous voyez un généraliste, qui demande des examens complémentaires ou vous réfère à un spécialiste. Le généraliste rédige une lettre à son confrère, et le spécialiste lui répond par un compte rendu.
Le même processus ne fonctionne plus du tout dès qu’il y a hospitalisation puisque le compte rendu de sortie est acheminé plusieurs semaines après la sortie, et il devient même aberrant dans un cadre chronique où son itération répétée génère une masse de documents considérable qui, par ailleurs (et heureusement pour lui) n’aboutissent pas tous chez le généraliste.
L’analyse de la masse de documents qui composent le dossier des patients qui paraissent justifier l’existence d’un DMP montre deux problèmes majeurs :
- Il n’est pas simple de distinguer les documents d’intérêt historique de ceux qui n’en ont pas. Par ailleurs, en général, plus un établissement produit de documents pour un même patient et moins ils ont d’intérêt historique. Par exemple à l’hôpital (la grande cible du DMP actuel, justement par son effet de levier volumétrique) la majorité des documents servent à préparer une intervention et n’ont pas d’intérêt ensuite.
- Le document que rédige un médecin contient trois types d’informations : des données d’intérêt général (poids, taille…), des données qui sont spécifiques à sa spécialité (« angle de vue » en gestion des connaissances) et n’outillent que sa propre prise de décision et enfin des données qui décrivent la vision qu’il a du processus clinique en cours (sur quoi on travaille, quelle inflexion donner au parcours de soins…).
Le terme « processus » est employé ici au sens très large de « support du travail d’équipe », donc neutre vis-à-vis du système d’information (en entreprise c’est l’objet des systèmes de gestion de projet, en musique symphonique, c’est assuré par le conducteur, le livret du chef d’orchestre…). Le problème en médecine, c’est que ni les logiciels des médecins, ni les systèmes hospitaliers, ni le DMP ne se préoccupent de cette tâche (précisément parce qu’ils sont exclusivement basés sur la gestion documentaire). Le corollaire, c’est que la démarche d’équipe reste implicite et que chacun (en fonction de la centralité de son rôle, de sa connaissance du patient, du temps qu’il consacre à interpréter le sens caché des documents, par exemple retrouver les problèmes en cours en fonction de la dernière ordonnance) se fait une idée personnelle du « processus fantôme » auquel il contribue.
Au final, un document médical contient donc quelques données d’intérêt générale, des données orientées angle de vue et l’évocation d’un processus fantôme.
La logique profonde du DMP, qui est de réaliser un dossier médical de continuité des soins par concentration des dossiers locaux, est donc particulièrement vaine ; non seulement parce que les documents d’intérêt historique seront noyés dans la masse (facteur aggravé par la course à la volumétrie qui pousse l’ASIP à connecter les hôpitaux), mais surtout parce que les documents qui ont un intérêt historique ne l’ont en réalité que pour leur auteur et, de toute façon, sont particulièrement pauvres en ce qui concerne la description de la démarche en cours, qui reste implicite et laissée à l’interprétation de chacun.
Comme chacun sait, quand on a un marteau pour seul outil, tous les problèmes à résoudre sont en forme de clou. Aussi, avec un peu de recul, on rira de constater que la solution la plus souvent évoquée à l’inutilité de ce « déversware documentaire » consiste précisément à y ajouter des documents supplémentaires, providentiellement baptisés « documents de synthèse », sans qu’on sache bien ni ce qu’ils contiendront, ni qui prendra le temps et le risque de les rédiger. Ne doutons pas que la prochaine étape consistera à élaborer une synthèse des synthèses.
Le DMP est essentiellement inutile. Contrairement à l’Internet qui, comme le dit Dominique Cardon, « élargit l’espace public », le DMP isole la médecine dans un mode de travail à l’ancienne, où la personne qui est censée justifie le P de Personnel n’a pas sa place et où chaque médecin à l’illusion de pouvoir continuer à travailler comme avant tout en bénéficiant par magie du travail des autres.
Demandez à un généraliste sa vision du DMP et il vous décrira la mise en ligne de son propre logiciel de gestion de cabinet, prêt à être abondée par tous les autres. Posez la même question à un spécialiste et vous obtiendrez quelque chose qui ressemble aux dossiers de réseaux de soins – ceux là même que les généralistes ne veulent plus remplir car ils détestent réduire le patient à sa maladie et ne peuvent supporter de voir éparpiller les données en cas de polypathologies. Vous ne demanderez pas à l’infirmière… et vous aurez tort car elle serait plus proche d’une vision opérationnelle… et, au fait, a-t-on demandé au patient ?
Pourquoi le DMP est aliénant
Comme je l’ai déjà évoqué, le DMP de l’ASIP est la réalisation du DMP du gouvernement. L’unicité ne se discute pas, non plus que la pertinence des solutions retenues… le truisme est sans échappatoire : le DMP réalisé est le DMP voulu puisqu’il n’existe qu’un seul terme pour définir… le DMP.
C’est une aliénation digne des Shadoks et que je raille fréquemment… mais que la plupart des gens prennent parfaitement au sérieux. Apportez une critique construite du DMP, comme celle qui est développée au chapitre précédent, et il vous sera immanquablement rétorqué quelque chose comme « puisqu’il est là, il faut s’en servir et demander des améliorations ». C’est à la fois logique et désarmant. C’est un peu si, après avoir démontré à quelqu’un que le train qu’il s’apprête à prendre part dans la direction opposée à sa destination, vous vous entendiez répondre « c’est le seul train dans la gare, je vais donc le prendre et je verrais bien si je peux lui faire faire demi-tour ». Ce comportement psychologique a été décrit par Jean-Pierre Dupuy dans son « Catastrophisme éclairé » comme le fait de se battre pour la meilleure place dans un train qui fonce vers le précipice.
En réalité, on n’invente jamais l’éclairage électrique en améliorant la bougie. Et un système mal né demande une telle débauche d’énergie à déployer que les virages drastiques y sont éternellement renvoyés à plus tard puisque la mise en œuvre quotidienne en est tellement problématique qu’elle consomme toute l’énergie disponible.
Il est important de comprendre que le « DMP du gouvernement » aurait pu être développé de mille manières. Le système monolithique actuel, le « DMP de l’ASIP » est assez dans la logique des systèmes d’information hospitaliers en France, où la majeure partie des fonctionnalités est concentrée dans un logiciel unique. Dans de nombreux autres pays, le SIH est une plateforme d’échange d’informations entre les multiples composants spécialisés qui outillent les services médicaux. De la même façon, on aurait pu créer un DMP en partant d’une démarche très conceptuelle, comme un ensemble de recommandation et la mise en œuvre de certains services considérés comme critique, ou par mise en œuvre d’une plateforme de services qui aurait permis à de nombreux acteurs d’ajouter leur pierre à l’édifice.
N’oublions pas que le succès des grands services venus des Etats-Unis, comme Amazon ou Facebook, provient en grande partie d’avoir su, en mettant leur concept de base au sein d’une plateforme applicative, agréger tout un écosystème d’entreprises qui participent à un cercle vertueux puisqu’elles étendent les fonctionnalités de la plateforme tout en bénéficiant immédiatement d’un vaste public potentiel… lui-même toujours croissant grâce à l’extension des services.
Le DMP ASIP est donc par essence unique et, par (manque de) conception, monolithique.
Il est clair pour tout architecte en système d’information qu’il est plus complexe et plus long de construire une plateforme extensible qu’un système autonome. Cette complexité et ce délai supérieur n’auraient pas permis de déployer le DMP Xavier Bertrand à grande échelle en 2007, ni de lancer le DMP Roselyne Bachelot avant 2011. De toute façon ces échéances n’ont pas été tenues. Par contre les choix techniques retenus, censés permettre le déploiement rapide d’un système simple, les rendent durablement improbables.
Cette contradiction entre « ambition urgente » et « bâclage incapacitant » n’est qu’un exemple des multiples cercles vicieux dans lequel le « dossier DMP » est enfermé depuis son origine. La raison profonde de ces désespérantes bévues permanentes est très clairement l’absence de sens du projet, que ce soit au sens propre de débâcle sémantique (parfaitement illustrée, comme je l’ai déjà évoqué, par la confusion de terme entre concept et implémentation) ou au sens figuré d’enjeu de société.
Dans un tel cas de figure, où des budgets conséquents sont disponibles pour un projet sans vision ni visibilité, les seules entreprises qui prospèrent sont celle qui sont capables de développer une stratégie purement opportuniste. Celui qui, au contraire, est en capacité d’innover dans le domaine n’a aucune moyen d’utiliser le DMP comme tremplin, ni possibilité de bâtir à côté, puisque le DMP revendique une exclusivité d’autant plus large que, s’il ne sert en réalité pas à grand-chose, il prétend, par son récent positionnement en continuité des soins, servir à tout (il est par ailleurs amusant de remarquer que cette contradiction entre une prétention extensive et une utilité douteuse est précisément ce qui a tué le concept de portails de l’époque pré-dot.com).
Pourquoi le DMP lutte contre l’innovation
Le DMP a donc vocation à être unique et à occuper intégralement le champ de la continuité des soins ; il est donc bien difficile de construire « à côté ». Comme c’est un produit monolithique et pas une plateforme, il ne permet pas d’héberger des services innovants, il n’est donc pas possible de construire « par-dessus ». Son architecture d’origine hospitalière basée sur la gestion documentaire est obsolète par rapport aux besoins modernes en gestion de processus, il est donc inutile de vouloir innover « à l’intérieur ».
Ni à côté, ni dessus, ni dedans… le positionnement de tout projet innovant est donc particulièrement périlleux ! La solution évidente est bien entendu d’être ailleurs (c’est celle que j’ai choisie), mais, après tout, il n’est pas si simple de définir cet ailleurs quand l’écart entre la fonctionnalité réelle et le champ d’action supposé du DMP est si vaste.
Prenons l’exemple de Sanoia. Cette jeune pousse s’est créée sur un principe simple et malin : les informations utiles en cas d’urgence peuvent parfaitement être d’accès public si personne ne sait à qui elles appartiennent. Il est alors très simple de mettre en ligne des informations qui vont se perdre parmi des dizaines de milliers d’autres données toutes aussi anonymes et de porter sur soi l’adresse du site Internet de Sanoia et l’identifiant, le numéro de « fiche », qui permet à l’homme de l’art de récupérer en quelques instants les informations qui lui permettront de vous prendre en charge efficacement.
L’idée est très bonne à la fois parce que le besoin est patent et bien défini et que la simplicité de mise en œuvre permet de le satisfaire à faible coût. Dans tout autre lieu, Sanoia pourrait être une perle innovante en forte croissance (en étasunien, une startup).
Par ailleurs, la « fiche Sanoia » n’est pas concurrente du DMP puisque, pour garantir son anonymat, elle ne doit bien entendu contenir aucune information nominative, que ce soit directement ou indirectement (c’est-à-dire en permettant des croisements d’informations trop précis ; par exemple connaitre la commune de résidence et le métier ou même la date de naissance exacte peut permettre une identification certaine). On est donc loin du cahier des charges de « continuité des soins », et Sanoia pouvait légitimement se considérer « ailleurs ».
Dans les faits, j’ai d’excellentes raisons de penser que Sanoia gêne l’ASIP et que cette agence d’état utilise tout son poids pour la mettre à terre. Le fait que la CNIL, qui avait initialement validé l’aspect anonyme des fiches Sanoia soit revenu sur cet avis après certaines critiques publiques n’est pas un hasard. La tribune de Jeanne Bossi, secrétaire générale de l’ASIP santé, titrée « Partager ses données de santé : ne pas se tromper » est parfaitement explicite : le DMP sert à tout et « laisser se développer des services qui ne s’inscrivent pas dans cette nouvelle logique et dans le respect d’exigences fortes prescrites par la loi et dorénavant applicables, c’est à la fois emmener le citoyen vers des chemins de traverse et freiner des évolutions dont l’actualité économique et démographique ne cessent de rappeler l’urgence. »
J’ai pris Sanoia pour exemple parce que c’est une entreprise pour laquelle j’ai à la fois une tendresse particulière et une absence totale de conflit d’intérêt, mais l’oukase de Jeanne Bossi est générique : la France est devenu le seul pays au monde où l’innovation en information de santé est l’apanage d’une agence d’état !
Pourquoi il faut mettre fin à ce projet
Après le rapport de la Cour des comptes, il est certain qu’un audit du projet va être mandaté. Une fois de plus des technocrates auditeront des technocrates afin de critiquer la gouvernance du DMP. Ils risquent fort peu, bien malheureusement, de mettre en doute comme je l’ai fait, son utilité, sa capacité d’aliénation du système de soins dans un paradigme obsolète et la lutte ouverte des membres de l’ASIP contre toute innovation susceptible de mettre en évidence leurs propres déficiences.
Je me garderais bien de reprendre ici le slogan de campagne de l’actuel président de la république. Je me contenterais d’une forme de pari de Pascal :
Tout d’abord, il faut bien constater qu’un projet qui a consommé près d’un demi-milliard d’argent public pour un résultat infinitésimal, qui, par ailleurs, est un frein aux évolutions nécessaires du domaine et bloque explicitement l’éclosion d’idées innovantes dans le domaine est l’archétype des désastres que la France n’a plus les moyens de financer.
Par ailleurs, un tel manque de sens de l’effort public est typiquement de nature à désespérer ceux à qui on demande de contribuer au redressement du pays en payant plus d’impôts.
Stopper le DMP, au contraire, c’est donner un triple signal :
- que les deniers de l’état doivent être investis sur des leviers du changement,
- que la santé est un des secteurs clés pour une nouvelle forme d’innovation par et pour le citoyen,
- que la santé est l’affaire de tous en terme de solidarité et de chacun en terme de gestion de son propre capital.
Ce sont les points que je détaillerai dans le prochain opus.